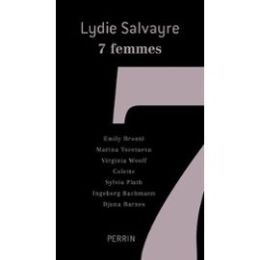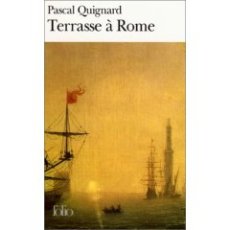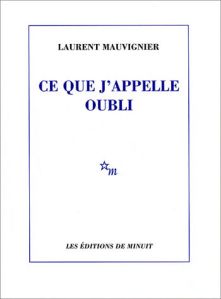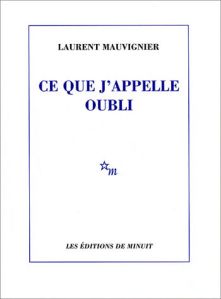
Souvent les textes de Laurent Mauvignier se sont vus qualifiés d’« écriture de l’évènement », surtout parce qu’ils entretiennent généralement un lien privilégié avec un certain nombre de faits divers, que l’on songe à la tragédie du Heyssel qui a donné lieu à Dans la Foule, ou encore à ce drame de la Part-Dieu, à Lyon, durant lequel un sans abri se faire rouer de coup par des vigiles, jusqu’à ce que mort s’ensuive, pour avoir volé une canette dans le centre commercial, et que reprend librement Ce que j’appelle oubli.
Cette dernière fiction – le terme est important – peut ainsi se lire comme la reconstitution de la scène terrible qu’a vécu cet homme dont jamais l’on ne saura le nom, jusqu’à ce moment où « il ne lui restera plus que la nudité et la froidure sur un matelas de fer ou d’Inox, et aussi, attachée à un doigt de pied, une étiquette avec son nom, un numéro » (p. 17). Il ne s’agit alors pas tant de dire cette mort que de la donner à vivre, que de nous la faire éprouver, par une plongée dans le cœur même du processus de mise à mort, dans toute la tension que cela suppose et qui se trouve restituée par le déploiement dans tout le corps du texte d’une unique phrase, qui nous tient en haleine. Toutefois l’orientation donnée au récit, qui veut que soit accordée aux perceptions et sensations une place de première importance, donne à penser que ce n’est pas tant la mort elle-même qui retient l’attention que la façon dont la vie peut échapper brusquement, alors que quelques minutes avant seulement, nous pouvions encore voir, sentir entendre tout ce qui nous entoure. Ainsi, la description des rayons du magasin, de l’allure des vigiles qui fondent sur l’homme, de la traversée vers la réserve, s’estompe progressivement pour ne laisser rapidement plus place qu’à celle d’un corps en train de lâcher peu à peu. Depuis le « nez qui éclate et [le] sang qui coule jusque sur la lèvre […] le sang [qui] coule dans sa bouche, (…) sa langue [qui] lèche le flot de sang, la surprise du sang sur ses doigts » (p. 21) au « cœur [qui] a lâché, le foie explosé, les poumons perforés » (p. 18), en passant par les « bras [qui] tombent aussi, l’abandonnent » et ce manque de force qui fait qu’« il ne peut pas les relever, ni les bras, ni les mains, ni les jambes non plus et la poitrine ne sait plus où trouver la ressource pour se soulever, prendre l’air, il faudrait de la force et il n’en a presque plus » (p. 26), l’on ne nous épargne aucun détail pour le dire, pour dire comment cette vie « se fait minuscule et finit par se faire la malle comme un parasite abandonne une carcasse qui ne lui convient plus » (p. 34).
Par là-même l’auteur replace l’humain au cœur de son projet, cet humain que tendent généralement à occulter les autres discours qui ont pu se déployer à partir de cette disparition, et qui tendent invariablement à la diluer derrière des considérations rationalisantes ou à la banaliser. Dès ses premières lignes, le récit devient alors l’occasion d’un retour réflexif sur ceux-ci, pour en dénoncer toute l’impropriété. Il s’inscrit d’abord dans le contrepoint des propos tenus par le procureur, qui voudraient qu’un « homme ne doit pas mourir pour si peu, qu’il est injuste de mourir à cause d’une canette de bière que le type aura gardée assez longtemps entre les mains pour que les vigiles puissent l’accuser de vol » (p. 7), comme si le caractère choquant de l’affaire ne tenait qu’au nombre de cannettes volées. Ce point fera ultérieurement l’objet d’un commentaire plus ironique et révolté : « il pourrait dire je vaux, je valais, une vie doit valoir un peu plus qu’une bière, un pack de six ? de douze ? de vingt-quatre bières, non, tu crois ? c’est trop ? et est-ce qu’en amassant de quoi remplir un Caddie le procureur aurait trouvé que c’était le juste prix et que ça ne valait pas plus ? que cette fois ils pouvaient y aller et lui donner une bonne correction et le faire payer plein pot » (p. 40). Seule demeure l’inanité de la déclaration, qui n’a d’égale que celle des « mots que la police a dits et répétés et qu’on a entendus dans les rues et les journaux, jetés sur la voie publique comme pour y faire pousser des fleurs (comme si toute la vérité du monde tenait là-dedans !) » (p. 37), toutes ces banalités qui perdent sans cesse de vue que ce qui s’est éteint là, c’est une vie, une vie singulière. Les rares fois où l’individu se trouve pris en compte, ce n’est généralement que pour tenter de l’incriminer, pour chercher des circonstances atténuantes aux responsables d’un meurtre pourtant si inacceptable : « ils ont tout fait pour essayer de la comprendre cette mort, tout fait pour lui donner un sens et la trouver un peu normale, ils ont écrit des papiers, ils en ont balancé sur lui pour savoir s’il était SDF ou quoi, s’il avait des antécédents et combien de vols à la tire ? ils en ont trouvé des trucs à dire, est-ce qu’il a fait de la taule ? des gardes à vue ? combien il a fait de gardes à vue, ton frère ? et est-ce qu’il était violent et alcoolique ? (…) il vivait en foyer, c’est ça ? dans quel foyer, avec qui ? d’allocations ? de quoi ? de petits boulots ou bien ». Rapidement, le défunt se trouve réduit par eux à une position sociale, à un casier judiciaire ; il n’est plus que ce sac que chacun peut « remplir de pierres, de gravats, de déchets » (p. 28). Dès lors, il est net que cette fiction tend à dépasser le cadre de ce moment d’extrême violence dont il est initialement question, pour devenir un véritable cri contre notre société, cette société dans laquelle nous disparaissons finalement en permanence, de façon insidieuse, jusqu’à ne plus être que « l’ombre d’un homme » (p. 39), ou même « un « tee-shirt jaune et noir » dont le « grotesque » (p. 32) déplaît au point de mériter des coups sans que cela n’émeuve particulièrement les foules, cette société dans laquelle « [l]a mort n’est pas l’évènement le plus triste de [l]a vie », parce que « ce qui est triste dans [l]a vie c’est ce monde avec des vigiles et des gens qui s’ignorent dans des vies mortes comme cette pâleur, cette mort tout le temps, tous les jours » (p. 60). S’intéresser au cas d’un marginal comme c’est ici le cas permet bien sûr de rendre cette dimension plus sensible encore, dans la mesure où il est par excellence celui face à qui « tous ont baissé les yeux parce qu’ils ont du travail qui les attend et une pelouse à tondre ou des trains à prendre, des enfants qu’il faut aller chercher à la sortie de l’école et aussi parce qu’ils espèrent échapper à leur propre misère, ce que j’appelle misère, à tous les malheurs quand sur le chemin c’est un type comme lui qu’ils croisent, nu comme un cauchemar, son visage crasseux éclairé par leurs phares en lieu et place des animaux à la sortie d’un bois » (p. 51). Il est celui auquel l’on préfère n’accorder aucune attention, et aucune place parmi nous. Il est celui dont on va jusqu’à ignorer qu’il puisse être un homme.
Tandis qu’elle met le doigt sur ce point, la fiction devient alors le lieu où le mort retrouve sa qualité d’homme. Elle est même le lieu où l’on rappelle « ses peurs d’enfants qu’il avait en regardant au-dessus de l’armoire, face au lit, la vierge phosphorescente dans sa boule de verre et la neige » (p. 53), ou encore « combien il aimait marcher dans les rues, des heures et des heures à ne plus sentir la douleur dans les jambes, [s]e protéger de la pluie sous le store d’un magasin ou dans une cabane téléphonique, l’orage sur Paris » (p. 57). Elle est aussi ce lieu où ressurgissent les paroles de sa mère, mais aussi la rencontre avec cette personne « voulait le revoir et que lui aussi voulait revoir, entre cette gare et la rue de Lyon », et plus largement toute cette famille, tous ces amis pour qui il était quelqu’un. L’adresse permanente au frère de la victime participe de cette même dynamique, tout en introduisant dans le texte un important pathos à même de refléter, en partie du moins, la douleur de la perte. En somme, tout concourt à dire qu’ « il va laisser sans lui les gens qu’il aime, [qu’]il y en a quelques-uns à qui il a tenu si fort, comme toi [son frère], des gens qui viendront espérer qu’un dieu existe autre part que dans la tête des hommes, quand ils verront le trou et le cercueil glissant, comme coulant au-dedans de cette terre épaisse et noire, avec les roses rouges qu’ils jetteront dessus » (p. 49), tout concourt à extirper cette existence de l’oubli.
Ecrire cette disparition c’est donc d’une certaine façon une occasion de dire avec Georges Perec « je me souviens », je me souviens de ce drame, je me souviens de cet homme, et surtout je me souviens de la valeur d’une vie, quelle qu’elle soit. C’est lutter contre cette petite mort quotidienne, « ce que j’appelle oubli », qui vous saisit quotidiennement dans les sociétés où prévaut l’indifférence générale. En ce sens, Laurent Mauvignier s’inscrit ici tout à fait dans cette lignée d’écrivains contemporains qui, comme François Bon, Marie Rovanet ou Le Clezio, refusent le silence et la faculté d’oubli de notre mémoire collective.